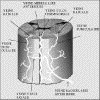EMBOLISATION
VERTEBRALE
ANATOMIE
Si la vascularisation artérielle
des enveloppes osseuses et musculaires de la moelle est riche puisqu'elle
provient de multiples artères métamériques, il en
est différemment pour les voies d'apport artérielles de la
moelle qui sont assez précaires : en effet, l'ensemble du cordon
médullaire n'est alimenté que par 6 ou 8 artères radiculo-médullaires
antérieures (destinées à 1 axe spinal antérieur)
et une vingtaine d'artères radiculo-médullaires postérieures.(destinées
aux axes spinaux postéro-latéraux).
La disposition de la vascularisation
des enveloppes osseuses et musculo-ligamentaires de la moelle est plus
simple puisqu'on ne distingue que deux régions cervicale et dorso-lombaire.

REGION CERVICALE
:
A ce niveau, la vascularisation vertébro-médullaire
est assurée par les branches ascendantes des artères sous-clavières
droite et gauche : artère thyroïdienne inférieure, cervicale
ascendante, vertébrale et cervicale profonde. Celles-ci s'organisent
en 3 axes : 1/ cervicaux antérieur ou pré-vertébral
(thyroïdienne inférieure et cervicale ascendante moyen
2/ latéro-vertébral (vertébrale) et
3/ postérieur (cervicale profonde).
Ces 3 axes sont largement anastomosés
entre eux par des rameaux horizontaux péri-vertébraux ou
intrarachidiens qui assurent la vascularisation des vertèbres. Ainsi,
la
vascularisation du corps des vertèbres cervicales est assurée
par des rameaux issus des artères thyroïdiennes, cervicales
ascendantes et vertébrales et l'arc postérieur par
les artères cervicales profondes et vertébrales.
C'est au niveau cervical que l'axe
spinal antérieur reçoit le plus d'afférences
artérielles (13 à 4).

Artère
spinale antérieure cervicale
- dans la région cervicale
haute (C1 à C3) il n'existe habituellement pas d'artère radiculo-médullaire
antérieure et les afférences à l'axe spinal antérieur
proviennent de la réunion de 2 artères spinales naissant
de la terminaison de chaque artère vertébrale.
- au niveau cervical moyen
et bas l'axe spinal antérieur est alimenté par 2 à
4 artères radiculo-médullaires antérieures naissant
indifféremment à droite ou à gauche de l 'artère
vertébrale ou de l'artère cervicale profonde exceptionnellement
de l'artère cervicale ascendante ou directement de l'artère
sous-clavière. Le plus souvent, il existe 2 artères radiculo-médullaires
principales, l'une naissant de l'artère vertébrale en regard
du trou de conjugaison C5-C6 ou C4-C5 et une artère, dite artère
du renflement cervical, naissant de l'artère cervicale profonde
et pénétrant dans le canal rachidien par le trou de conjugaison
C7-D1. Cette artère assure la vascularisation du renflement cervical
mais peut être remplacée par une artère radiculo-médullaire
issue de l'artère vertébrale et satellite de la 6 ème
racine cervicale.
Les axes spinaux postérieurs
sont grêles et sont alimentés par 4 à 6 artères
radiculo-médullaires postérieures très fines naissant
de l'artère vertébrale entre C3 et C6.
A ce niveau, les possibilités
de suppléance en cas d'occlusion d'une des artères radiculo-médullaires
sont le plus souvent bonnes, ce dont témoigne la rareté des
accidents médullaires observés lors des occlusions athéromateuses
ou thérapeutiques de l'artère vertébrale.

REGION
DORSALE ET LOMBAIRE
La vascularisation du rachis et de
la moelle est assurée par les artères intercostales et lombaires
issues par paires de la face dorsale de l'aorte.
1-VASCULARISATION
DU RACHIS :
Sur le plan vasculaire, les vertèbres
sont également constituées de deux parties distinctes : le
corps vertébral et l'arc postérieur.
-
VASCULARISATION DU CORPS VERTEBRAL :
Elle est alimentée par deux groupes
artériels. Le groupe antérieur formé de multiples
petites branches périostiques issues du tronc de l'artère
intercostale qui vont vasculariser la portion périphérique
des faces antérieure et latérale du corps vertébral.
Le groupe postérieur alimentant
la plus grande partie de la vascularisation du corps vertébral provient
de la branche antérieure du canal rachidien (artère rétro-corporéale),
par l'intermédiaire de 2 rameaux perforants pénétrant
dans le corps vertébral par son hile vasculaire dont les branches
vascularisent la face postérieure du corps vertébral, et
la plus grande partie de la zone centro-corporéale.

-
VASCULARISATION COSTO-VERTEBRALE :
Elle est alimentée par des rameaux
provenant de la branche antérieure de l'artère inter-costale,
les deux rameaux provenant de l'artère dorso-spinale durant son
trajet dans la gouttière para-vertébrale.
-VASCULARISATION
DE L'ARC POSTERIEURE
celui-ci reçoit également
un apport double intra-canalaire par des branches situées dans l'espace
épidural postérieur (artère pré-mammaire) issues
de la branche intra-canalaire postérieure de l'artère dorso-spinale.
Elle reçoit également
des afférences extra-rachidiennes périostées provenant
du rameau interne de division de la terminaison de l'artère dorso-spinale.

2-VASCULARISATION
DE LA MOELLE :
Si la disposition de la vascularisation
du rachis est identique sur l'ensemble du rachis dorsal et lombaire, il
en est différemment de la vascularisation de la moelle où
il faut distinguer à la suite de Lazorthes, deux territoires distincts
dorsal supérieur et moyen et dorso-lombaire.
-DORSAL
SUPERIEURE ET MOYEN (D3 À D7) :
Ce territoire se caractérise par
sa pauvreté vasculaire donc sa plus grande fragilité.
Dans toute cette région, il
n'existe qu'une seule artère radiculomédullaire antérieure.
Elle naît habituellement de la branche postérieure dorso-spinale
de la 4è ou 5è artère intercostale, plus souvent à
gauche (80 % des cas) qu'à droite.
Les artères radiculo-médullaires
postérieures sont de même peu développées et
en nombre variable, de 4 à 9. Celles-ci naissent de la branche dorso-spinale
de l'artère intercostale, après le croisement de Ia racine
nerveuse, longent sa face postérieure, puis traversent la dure-mère
et se dirigent en haut et en dedans jusqu'au sillon collatéral postérieur
où elles rejoignent l'axe spinal postérieur.
Il faut signaler l'existence très
fréquente d'un tronc commun d'origine de la 4è ou 5è
artère intercostale droite et de l'artère bronchique du lobe
inférieur droit. Dans certains cas, ce tronc peut fournir l'artère
radïculo-médullaire antérieure du segment dorsal et
cette disposition anatomique est certainement responsable .des complications
neurologiques qui ont pu être observées au décours
d'une embolisation des artères bronchiques.
Enfin, parmi les variations anatomiques,
il faut signaler la possibilité de vascularisation partielle ou
complète du territoire dorsal supérieur par des branches
de l'artère sous-claviére.

-TERRITOIRE
DORSO-LOMBAIRE :
A ce niveau, la vascularisation vertébro-médullaire
présente la même disposition qu'au niveau dorsal supérieur,
les artères intercostales et lombaires sont souvent plus volumineuses
et leurs anastomoses plus développées, notamment au niveau
lombaire.
L'axe spinal
antérieur reçoit le plus souvent une afférence
unique, l'artère d'Adamkiewicz, volumineuse, qui assure la majeure
partie de la vascularisation de la moelle dorsale basse et du renflement
lombaire .Son origine est située, dans 70% des cas, du côté
gauche et se fait entre D9 et L2 dans 80 % des cas.
Lorsque son origine est bas située,
au-dessous de D12, il existe souvent une artère radiculomédullaire
antérieure dorsale moyenne naissant de la 7è ou 8è
artère intercostale. Il n'est pas exceptionnel, notamment chez l'enfant
ou l'adulte jeune, d'observer la présence d'une ou deux artères,
radiculo-médullaires antérieures supplémentaires dans
la région dorsale basse.
Les artères
radiculo-médullaires postérieures (spinales postérieures)
sont bien développées à ce niveau, et on en dénombre
habituellement de 4 à 8. Deux d'entre elles, plus développées,
sont constantes : il s'agit des artères spinales postérieure
du cône. Elles naissent habituellement entre D12 et L3 et s'anastomosent
avec la terminaison de l'artère d'Adamkiewicz pour former l'anse
anastomotique du cône.

Artère
spinale antérieure et anastomoses à risques
Enfin, il faut signaler la présence
d'artères radiculaires très grêles, satellites des
racines lombaires, et qui pourraient assurer un rôle de suppléance
pour la vascularisation du cône terminal en cas d'occlusion de l'artère
d'Adamkiewicz

LES
VEINES :
Les études concernant le retour
veineux médullaire sont peu nombreuses. Leur disposition anatomique
se rapproche de celle des artères : en effet, les veines intramédullaires
se jettent dans les veines péri-médullaires antérieure
et postérieure. Celles-ci se drainent dans des veines médullo-radiculaires
et, de là, dans les plexus intrarachidiens.
LE
RESEAU VEINEUX MEDULLAIRE
Celui-ci est formé de veines
centrales qui présentent une disposition radiée et se jettent
directement ou par l'intermédiaire de veines péri-médullaires
horizontales dans 2 veines principales : la veine spinale antérieure
et la veine spinale postérieure, dont le calibre et le trajet sont
très variables, mais la disposition la plus fréquente mérite
d'être signalée :
- la veine spinale antérieure,
médiane et rectiligne, chemine dans le sillon médian antérieur
et draine le quart antérieur de la moelle. Cette veine apparaît
continue de extrémité céphalique à extrémité
caudale de la moelle ;
. - la veine spinale postérieure
est sinueuse et chemine de part et d'autre de la ligne médiane,
son calibre est plus important que la précédente et elle
est souvent plus volumineuse au niveau du renflement lombaire ou cervical.
Enfin, il faut noter qu'elle peut être dédoublée dans
la région cervicale. Cette veine draine les 3/4 postérieurs
et latéraux de la moelle.

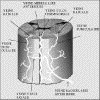
Schéma
et description du réseaux veineux périmédullaire
VEINES
EFFERENTES
Celles-ci sont formées des
veines médullo-radiculaires antérieures et postérieures
en nombre variable. Habituellement, il existe 2 ou 3 veines médullo-radiculaires
dans la région cervicale, une au niveau dorsal haut, une au niveau
dorsal moyen, 2 au niveau du cône et 1 dans la région lombaire
(veine du filum).Ces veines se jettent dans les plexus intrarachidiens
en regard des trous de conjugaison.

EMBOLISATION
MECANISME
Le but de l'embolisation vertébrale
est de réduire de manière significative l'hypervascularisation
liée à l'angiogénèse d'origine tumorale.
Il résulte de l'embolisation
l'apparition d'une nécrose tumorale si l'ensemble des pédicules
participant à la néovascularisation ont été
traité.
L'intérêt est triple
:
1- Elle peut permettre par la diminution
du saignement per-opératoire une prise en charge plus facile de
certaine tumeurs hypervasculaires primitives du rachis ou de métastases
hypervasculaires (rein, thyroïde ...) en réduisant de manière
significative le saignement per-opératoire de ces lésions.
2- Par la nécrose tumorale
qu'elle entraîne, l'embolisation aboutit à une diminution
du syndrome de masse réalisé par l'envahissement tumoral
et permet parfois une levée partielle ou complète d'une compression
nerveuse au delà d'autres ressources thérapeutiques comme
la chirurgie ou la radiothérapie.
3- Enfin et sans doute liée
aux deux mécanismes précédent l'embolisation peut
atténuer de manière significative les douleurs vertébrales
liées à l'envahissement tumoral.
On peut dans certaines circonstances
et notamment pour des lésions secondaires peut nombreuses ( une
ou deux), et d'évolution lente joindre une chimiothérapie
locale intra-artérielle en réalisant une chimioembolisation.
L'intérêt ici de la chimiothérapie pour des lésions
réputées chimiosensibles est d'apporter localement une concentration
importante au sein de la tumeur de cytostatiques type alkylant ou anthracyclines
à des doses faibles comparativement au doses injectées pour
une cure IV.
De ce fait découle donc une
meilleure tolérance clinique et des effets secondaires notamment
hématologiques atténués.
On rappel que l'administration intra-artérielle
de cytostatique doit rentrer dans le cadre de protocoles déjà
utilisés et après conseil multidisciplinaire puisque ce traitement
est hors cadre AMM pour les produits suscités.

TECHNIQUE
Elle est commune à l'angiographie
diagnostique vertébromédullaire et partage donc ces grands
principes.
Ainsi elle repose sur une parfaite
connaissance de l'anatomie vasculaire artérielle et veineuse vertébromédullaire.
On aura au préalable expliqué
au patient les avantages mais aussi les inconvénients et les risques
de la technique.
Un bilan de coagulation, une NFS
et un ionogramme sont indispensables pour éviter tous risques de
saignement , d'insuffisance rénale compte tenu du volume d'iode
injecté et pour s'assurer avant une éventuelle chimioembolisation
l'absence de déplétion des cellules des lignées rouges
ou blanches. Bien sûr une allergie aura été si nécessaire
prémédiquée.
Les examens sont réalisés
sous neuroleptanalgésie de préférence.
Le cathétérisme est
habituellement artériel fémoral (seldinger) et l'on utilisera
un introducteur adapté au calibre des sondes utilisés (5F
le plus souvent). Cet introducteur permet un changement facile de sondes
qui est parfois fréquent compte tenu des variations d'accès
aux artères intercostales ou lombaires.
La durée du geste doit conduire
à utiliser un système de rinçage en continu de l'introducteur
et de tout système coaxial introduit dans le réseau vasculaire
du patient au risque de migration embolique ou d'occlusion de sonde porteuses
notamment des microcathéters.
Une cartographie angiographique est
hautement souhaitable dans le but de repérer les artères
spinales antérieure ou postérieure avant tout geste d'embolisation.
Le principe de STABILITE de la sonde
au niveau d'une intercostale ou d'une lombaire est fondamental pour éviter
toute migration de matériel d'occlusion vers l'aorte et ses branches.
Ainsi on adaptera le choix de la
sonde à la forme des vaisseaux cathétérisés
pour s'assurer d'une introduction de la sonde bien au-delà de l'ostium
artériel. Si le cathétérisme reste limité on
s'aidera d'un microcathéter pour atteindre le distalité de
l'artère à emboliser.

Adéquation
sonde-artère
Il est impératif de respecter
les artères radiculo-médullaires antérieures et postérieures.
Une fois en place une angiographie
de qualité est réaliser pour s'assurer une dernière
fois de l'absence de branches artérielles à destinée
médullaire ou d'anastomose dangereuses.

Anastomoses
dangereuses
Après chaques séquences
d'embolisation un contrôle angio est nécessaire pour éliminer
l'apparition d'anastomoses dangereuses qui peuvent se révéler
à l'extinction du phénomène de vol d'hypervascularisation
tumorale. Il est souvent nécessaire d'emboliser des deux côtés
ainsi que les étages sus et sous jacent compte tenu des anastomoses
transverses et cranio-caudales.

MATERIEL
Les sondes utilisées
doivent s'adapter à la configuration des branches à cathétériser.
Les plus utilisées sont les
sondes dites COBRA qui peuvent avoir différentes courbures (type
I, II, III ). Pour les artères lombaires basses et les branches
à destinée rachidienne de l'artère hypogastrique ont
peut utiliser la contre courbure de ces sondes pour les transformer en
SIMMONS.

SONDES
Les Microcathéters sont
parfois indispensables si l'on veut éviter tout risque de reflux
.On citera le Mag 2F-3F remplacé récemment par le Magellan.
Les agents d'occlusion les plus utilisés
sont les particules d'Ivalon (ultra Drivalon) calibrés en 150 -250,
250-500 microns , les Embosphères et parfois pour traiter un tronc
porteur des coils libres.
L'intérêt de la numérisation
est d'apporter par la soustraction une très bonne qualité
d'imagerie, de réduire les doses de contraste injecté avec
une réduction du temps de l'éxamen.

COMPLICATIONS
Entre des mains expérimentées
ces complications sont faibles, puisque le risque majeur est l'embolisation
d'une artère à destinée médullaire et que les
précautions citées précédemment rendent ce
risque heureusement exceptionnel.
Les autres complications sont en
rapport avec le point de ponction comme l'hématome ou la fistule
artério-veineuse fémoro-fémorale.
INDICATIONS
Elle doivent être posées
dans le cadre de réunions multidisciplinaires associant cancérologues,
radiothérapeutes, chirurgiens et radiologues.
Elles concernent les lésions
hypervasculaires secondaires comme les métastases de cancers thyroïdiens,
rénaux, mélanomes ou de phéochromocytomes.

Cas
clinique embolisation de métastases
Elles peuvent aussi concerner des
lésions primitives réputées hémorragiques au
cours des abords chirurgicaux (Tumeurs à cellules géantes,
angiomes vertébraux, ostéoblastomes bénins, kystes
anévrysmaux).

Cas
clinique embolisation de métastases lombaires (2)
Le but de l'angiographie est alors
de démontrer l'hypervascularisation, de localiser les axes spinaux
antérieurs et de permettre enfin l'embolisation.

Cas
clinique embolisation d'une métastase cervicale
AJOUTER
UN CAS CLINIQUE

|